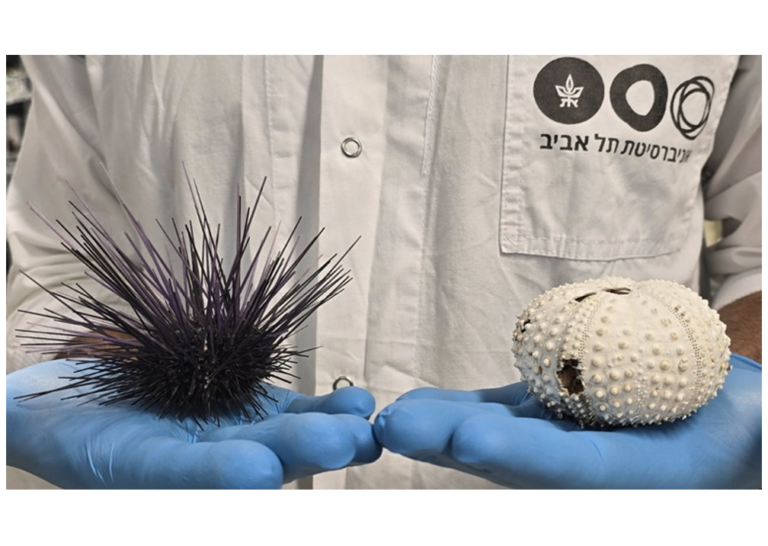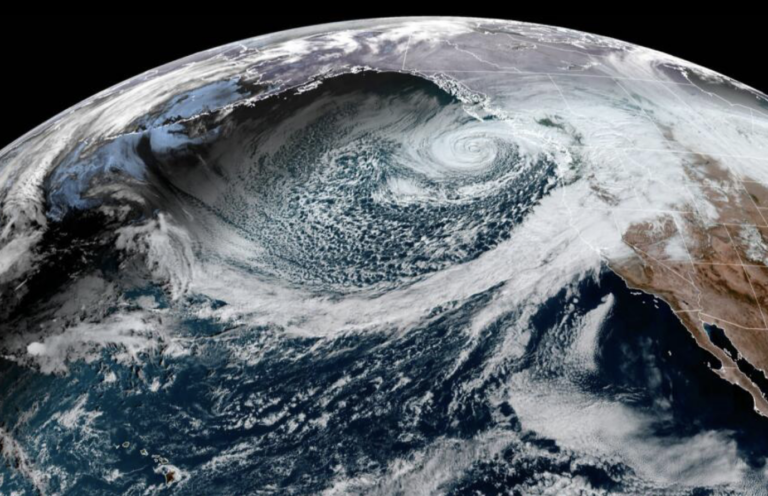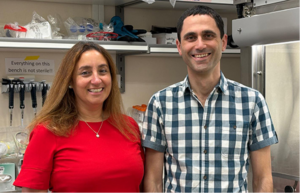Institut Weizmann : des chercheurs découvrent comment des organismes prospèrent à des températures supérieures à 80°C

« S’adapter ou périr, aujourd’hui comme hier, tel est l’impératif inexorable de la nature », écrivait H. G. Wells. Ce principe, la survie exige le changement, a été maîtrisé il y a des milliards d’années par des organismes unicellulaires vivant dans des conditions de chaleur extrême. Ces dernières décennies, l’étude des mécanismes d’adaptation de ces organismes a permis le développement de technologies révolutionnaires, de la réplication rapide de l’ADN (PCR) à la production de protéines thermorésistantes, en passant par la génération de carburants et de produits chimiques. Les plus remarquables de ces organismes sont les hyperthermophiles, qui vivent dans les cratères volcaniques, les sources hydrothermales et les sources chaudes, des environnements où les températures dépassent 80°C.
Une nouvelle méthode mise au point par des chercheurs de l’Institut Weizmann des Sciences (Israël) révèle comment les hyperthermophiles modifient les molécules d’ARN au cœur de leur ribosome – l’usine de production de protéines de la cellule – pour survivre dans des environnements extrêmement chauds. Les travaux du laboratoire du Pr Schraga Schwartz, remettent en question l’hypothèse selon laquelle les processus vitaux fondamentaux sont uniformes d’une espèce à l’autre et tout au long du vivant. Ces découvertes pourraient mener à des améliorations des technologies médicales et industrielles basées sur l’ARN et éclairer un mystère de longue date dans le développement de médicaments. Le ribosome est l’une des structures biologiques les plus anciennes et les plus fondamentales, présente chez les trois domaines du vivant : les archées, les bactéries et les eucaryotes. À la fin des années 1950, des chercheurs ont découvert que les molécules d’ARN ribosomique subissent une « édition chimique » (modification) après leur production dans la cellule. Cependant, la difficulté à mesurer ces modifications ne permettait pas de déterminer précisément leur variabilité entre les espèces ou en fonction des conditions environnementales.
« Jusqu’à récemment, on supposait généralement, principalement sur la base de recherches menées sur la levure et l’homme, que la modification de l’ARN dans le ribosome était uniforme chez tous les membres d’une même espèce et ne variait pas en fonction de l’environnement », explique le Pr Schwartz, du département de génétique moléculaire de l’université Weizmann. Cependant, ces dernières années, des preuves ont émergé chez quelques espèces suggérant que la modification peut parfois être dynamique, permettant à la structure ribosomique de s’adapter à l’environnement. Néanmoins, confirmer ce phénomène à grande échelle s’avérait difficile en raison du grand nombre de types de modifications, de la complexité de leur identification et des limitations des méthodes existantes, qui ne permettaient généralement aux chercheurs d’examiner qu’un seul type de modification par échantillon et un seul échantillon à la fois.
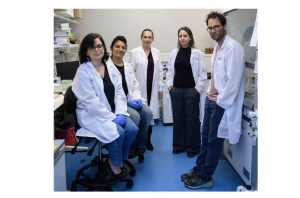
Le nouveau système, développé au sein du laboratoire du Pr Schwartz sous la direction du Dr Miguel A. Garcia-Campos, permet aux scientifiques d’examiner 16 types de modifications sur des dizaines d’échantillons d’ARN, une avancée majeure pour la recherche sur l’édition de l’ARN.
Grâce à ce système, les chercheurs ont cartographié les profils de modification chez 10 organismes unicellulaires et les ont comparés à ceux de quatre espèces précédemment étudiées. Ils ont délibérément privilégié les extrêmophiles – des organismes qui prospèrent dans divers environnements extrêmes – dont trois hyperthermophiles, en émettant l’hypothèse que les mécanismes d’adaptation environnementale ribosomique étaient plus susceptibles d’avoir émergé chez ces organismes. « Alors que la plupart des bactéries et des archées se contentent de quelques dizaines de modifications de l’ARN ribosomique, nous en avons trouvé des centaines chez les espèces hyperthermophiles », note Schwartz.
« En fait, nous avons constaté que plus l’environnement naturel d’un organisme est chaud, plus son ribosome subit de modifications. » Ayant observé des différences entre les espèces provenant d’environnements différents, les chercheurs se sont ensuite demandé si une espèce pouvait modifier son ARN ribosomique – et donc la structure de son ribosome – en réponse aux changements environnementaux au cours de sa vie. Pour le vérifier, ils ont cultivé chaque espèce dans trois à cinq conditions différentes. Chez les mésophiles, des micro-organismes qui prospèrent à des températures modérées, la plupart des modifications étaient permanentes et ne variaient pas en fonction de l’environnement. En revanche, près de la moitié des modifications chez les hyperthermophiles étaient dynamiques, se produisant à davantage de sites sur les molécules d’ARN à mesure que la température augmentait. Les chercheurs ont conclu que les modifications de la structure ribosomique sont non seulement possibles, mais constituent un important mécanisme d’adaptation.
Plus précisément, trois types de modifications se sont avérés devenir systématiquement plus fréquents avec l’augmentation de la température. « L’une des découvertes les plus surprenantes a été que l’une de ces modifications – l’ajout d’un groupe méthyle, ou méthylation – apparaissait presque toujours chez les espèces hyperthermophiles en même temps qu’une autre modification : l’ajout d’un groupe acétyle, ou acétylation », explique le Pr Schwartz. « Cela suggérait que les deux agissaient de concert. Nous avons collaboré avec l’équipe du Pr Sebastian Glatt à l’Université Jagellonne de Cracovie pour tester la stabilité des molécules d’ARN sans aucune addition, avec l’une ou l’autre, et avec les deux ».
La méthylation et l’acétylation ont toutes deux un effet stabilisateur sur l’ARN, mais leur combinaison produit un effet supérieur à la somme de leurs effets individuels. Ce qui restait obscur, c’était la manière dont cette modification chimique altère la structure du ribosome. Pour le découvrir, les chercheurs se sont associés à l’équipe du Pr Moran Shalev-Benami du département de biologie chimique et structurale de l’institut Weizmann, qui a utilisé la cryo-microscopie électronique pour cartographier le ribosome d’une archée hyperthermophile. Ils ont cartographié la structure dans deux états : lorsque l’enzyme responsable de la méthylation à haute température était active et lorsqu’elle était inhibée. Les groupements méthyle ajoutés à haute température se sont révélés répartis sur l’ensemble du ribosome, formant des liaisons faibles avec les molécules environnantes, ce qui, ensemble, renforce la structure globale. De même, les régions où la modification a eu lieu présentaient moins d’espaces, « colmatant » ainsi les brèches du ribosome. Ces découvertes révèlent un mécanisme sophistiqué dans lequel de subtiles modifications chimiques des molécules d’ARN peuvent considérablement améliorer la stabilité du ribosome, lui permettant de fonctionner dans des environnements changeants.
Elles pourraient également contribuer à expliquer le phénomène de longue date du « méthyle magique » – une augmentation inexpliquée de plus de cent fois de la concentration de méthyle. L’ajout d’un groupe méthyle modifie l’efficacité de certains médicaments. « Il semble désormais probable qu’au moins certaines modifications d’une molécule d’ARN – comme la méthylation et l’acétylation – n’agissent pas indépendamment et doivent être décryptées comme un code combinatoire », explique le Pr Schwartz. « Notre étude de l’ARN ribosomique contribue à clarifier l’interaction entre les différentes modifications, et la méthode que nous avons développée pourrait accélérer et étendre l’étude de nombreux types de modifications et de nouvelles espèces. »
« De nombreuses technologies basées sur l’ARN sont actuellement commercialisées ou en développement – des vaccins contre les pandémies aux outils de diagnostic et de thérapie du cancer, en passant par les outils d’édition génique utilisés en biotechnologie et en médecine », ajoute-t-il. « Le processus naturel d’édition de l’ARN s’est perfectionné au cours de milliards d’années, et percer ses secrets pourrait ouvrir la voie à des technologies basées sur l’ARN plus fiables et plus efficaces. »
Joe Georgeson, le Dr Ronit Nir, le Dr Vinithra Iyer et le Dr Anatoly Kustanovich du département de génétique moléculaire de Weizmann ont également participé à l’étude ; Dr Robert Reichelt, Dr Felix Grünberger, Nicolas Alexandre, Pr Sébastien Ferreira-Cerca et Pr Dina Grohmann de l’Université de Ratisbonne, Allemagne ; Dr Kristin A. Fluke, Pr Brett W. Burkhart et Pr Thomas J. Santangelo de l’Université d’État du Colorado, Fort Collins, Colorado ; Dr Donna Matzov du département de biologie chimique et structurale de Weizmann ; Dr Lauren Lui du Laboratoire national Lawrence Berkeley, Californie ; Dr Supuni Thalalla-Gamage, Dr Shereen A. Howpay-Manage et Dr Jordan L. Meier du National Cancer Institute, Frederick, Maryland ; Dr Milan Gerovac et professeur Jörg Vogel de l’Université de Würzburg, Allemagne ; Dr Yuko Nobe et Prof. Masato Taoka de l’Université métropolitaine de Tokyo (Japon) ; Jakub S. Nowak de l’Université Jagellonne de Cracovie (Pologne) ; Manoj Perera, Alexander Apostle et le Dr Shiyue Fang de l’Université technologique du Michigan (Houghton, Michigan) ; le Dr Ghil Jona du département des plateformes de recherche en sciences de la vie de l’Institut Weizmann ; et le Pr Eric Westhof de l’Institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg (France). Les travaux de recherche du Pr Schraga Schwartz sont financés par le Centre de thérapie ARN Abisch-Frenkel et le Centre intégré de cancérologie Moross.
Publication dans la revue Cell 22 octobre 2025